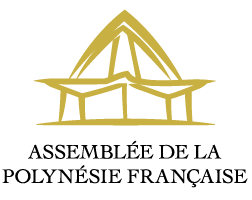Réunion d'information sur la "Présentation de l'étude de santé MATAEA"
Le mercredi 17 septembre 2025, les membres de la commission de la santé et des solidarités, présidée par Mme Patricia PAHIO-JENNINGS, se sont réunis pour la présentation des résultats de l'étude MATAEA, conduite par l'Institut Louis-Malardé (ILM), représenté par sa directrice générale, Mme Maire SABRE.
La restitution a été assurée par le Dr Van Mai CAO-LORMEAU, directrice du laboratoire de recherche sur les infections virales émergentes, accompagnée du Dr Maite AUBRY, chargée de recherche, et du Dr Iotefa TEITI, également chargé de recherche.
L'étude MATAEA constitue une enquête de santé d'envergure inédite, réalisée dans les cinq archipels de Polynésie française entre fin 2019 et décembre 2021. Cette recherche, dont le déroulement a été perturbé par la pandémie de la Covid-19, visait à établir un état des lieux complet de la santé des populations polynésiennes, avec une attention particulière portée aux différences inter-archipels.
Les scientifiques ont ainsi exploré différents aspects de la santé des participants, notamment leur mode de vie, des mesures physiques comme le poids et la taille, des analyses de sang, la détection de virus et d’anticorps, ainsi que l’étude des bactéries présentes dans l’intestin, appelées microbiote. Ils ont également analysé une partie du patrimoine génétique des participants, en collaboration avec l’Institut Pasteur de Paris.
L'étude a inclus 1942 participants adultes répartis dans 18 îles, avec une représentation équilibrée entre hommes et femmes et trois groupes d'âge (18-29 ans, 30-44 ans, 45-69 ans). La sélection des foyers s'est effectuée par tirage au sort sur la base du recensement de 2017, garantissant ainsi la représentativité de l'échantillon.
L’enquête a révélé des chiffres préoccupants en Polynésie française : plus de la moitié des adultes sont obèses, et 12 % souffrent de diabète. L’hypertension touche jusqu’à 57 % des plus de 60 ans.
Les virus transmis par les moustiques demeurent une menace constante, en particulier le chikungunya. Par ailleurs, la diminution des anticorps contre le Zika avec le temps expose la population à un risque de nouvelle épidémie.
En ce qui concerne la vaccination contre l’hépatite B, obligatoire depuis 1996, elle a quasiment éliminé le virus chez les générations les plus jeunes.
En revanche, la ciguatera, intoxication alimentaire liée aux poissons récifaux, touche plus d’un habitant sur deux aux Gambier.
Enfin, une analyse génétique confirme un métissage ancien entre populations austronésiennes et papoues, enrichi par des échanges génétiques plus récents.
Les échanges avec les élus ont soulevé plusieurs préoccupations majeures. La question des liens potentiels entre les essais nucléaires et certaines pathologies, notamment la forte prévalence de ciguatera aux Gambier, a été évoquée sans pouvoir être documentée scientifiquement en l'absence de données antérieures aux essais.
Les représentants de l’Assemblée ont également souligné l'urgence d'agir face aux taux d'obésité alarmants, évoquant la nécessité de réformer les habitudes alimentaires et de lutter contre la consommation de produits ultra-transformés. La transformation du mode de vie polynésien depuis l'installation du Centre d'Expérimentation du Pacifique a été identifiée comme un facteur explicatif majeur de l'évolution épidémiologique.
L'étude MATAEA constitue une avancée scientifique majeure pour la compréhension de la santé en Polynésie française. Ses résultats, en cours de publication dans des revues scientifiques internationales, fourniront aux autorités sanitaires les outils nécessaires à l'élaboration de politiques de santé publique adaptées aux spécificités locales. La poursuite de cette recherche et son extension à d'autres problématiques de santé apparaissent essentielles pour accompagner les défis sanitaires futurs de la Polynésie française.